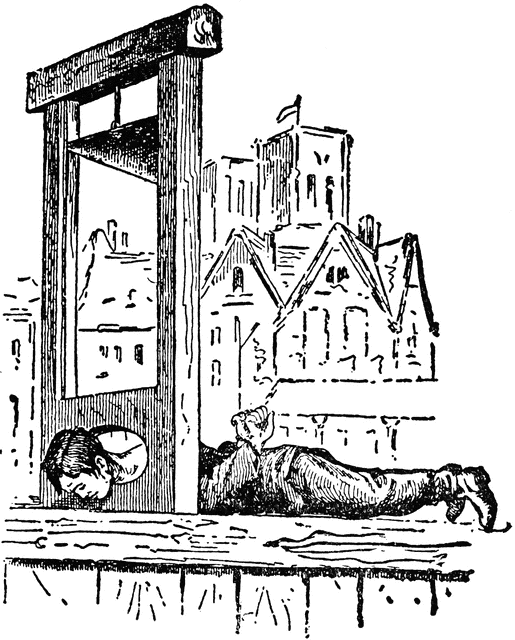 Guillotin est un personnage politique majeur de la révolution française. Malheureusement, certains l’ont accusé d’être le père de la guillotine. Faux. Il a demandé la création d’une machine pour « humaniser » les exécutions. Il n’a jamais justifié le crime mais il a essayé de le rendre moins abject. Guillotin était épris de justice. Il était d’ailleurs contre la peine de mort et haïssait la souffrance et la cruauté.
Guillotin est un personnage politique majeur de la révolution française. Malheureusement, certains l’ont accusé d’être le père de la guillotine. Faux. Il a demandé la création d’une machine pour « humaniser » les exécutions. Il n’a jamais justifié le crime mais il a essayé de le rendre moins abject. Guillotin était épris de justice. Il était d’ailleurs contre la peine de mort et haïssait la souffrance et la cruauté.
A cette époque, les mises à mort traînaient en longueur. Si la décapitation au sabre demeurait réserver aux nobles, les voleurs et autres criminels étaient roués en place publique, écartelés, bouillis vifs dans un chaudron… Durant des années, Guillotin s’était aussi battu pour l’égalité des peines en dépit du rang social. Dans sa résistance, il prononça à l’Assemblée nationale, le 1er décembre 1789, un discours sur le Code pénal avec la nécessité de le réformer. « La loi, dit-il, soit qu’elle punisse, soit elle protège, doit être égale pour tous les citoyens, sans aucune exception. » Au regard de cet engagement courageux, la conférence abordera le parcours d’un grand humaniste.
L’utilisation d’un appareil mécanique pour l’exécution de la peine capitale lui paraissait une garantie d’égalité, qui devait selon lui ouvrir la porte à un futur où la peine capitale serait finalement abolie. Son idée fut adoptée en 1791 par la loi du 6 octobre et, malgré ses protestations, on attribua son nom à cette machine, qui existait pourtant depuis le XVIe siècle. Après plusieurs essais sur des moutons puis trois cadavres à l’Hospice de Bicêtre le 15 avril 1792, la première personne guillotinée en France fut un voleur, du nom de Nicolas Pelletier, le 25 avril 1792.
L’appareil fut mis au point en 1792 par son confrère Antoine Louis, secrétaire perpétuel de l’Académie de chirurgie (d’où son premier nom de Louison), et se vit rapidement affublé du nom de guillotine, contre la volonté du docteur Guillotin qui en manifesta le regret jusqu’à sa mort en 1814.
Guillotin espérait instaurer une exécution plus humaine et moins douloureuse. Mais, pendant la Terreur, celle qui est désormais affublée de nombreux noms (comme le rasoir national, le moulin à silence, la veuve, puis la cravate à Capet après son emploi sur Louis XVI) a largement contribué à multiplier les exécutions capitales.


 addicted2salsa.com
addicted2salsa.com twitter.com/fitao
twitter.com/fitao websitegrader.com/
websitegrader.com/ xml-sitemaps.com
xml-sitemaps.com